Les managers jouent un rôle central dans le succès de l'onboarding, en posant les bases d'une intégration fluide et engageante. Découvrez comment leur implication dès le départ permet d'accompagner efficacement les nouvelles recrues, tout en favorisant leur engagement et leur motivation pour une intégration réussie.
Télécharger la ressourceVous avez sans doute remarqué que certaines personnes semblent naturellement capables de gérer leurs propres émotions et de comprendre celles des autres. Pourtant, selon Daniel Goleman, cette compétence, appelée intelligence émotionnelle, serait responsable de deux tiers des performances d'une entreprise et peut se développer à tout âge. Dans cet article, vous découvrirez ce qu'est réellement l'intelligence émotionnelle, comment l'évaluer et, surtout, comment la renforcer concrètement afin d'améliorer vos relations personnelles et professionnelles.
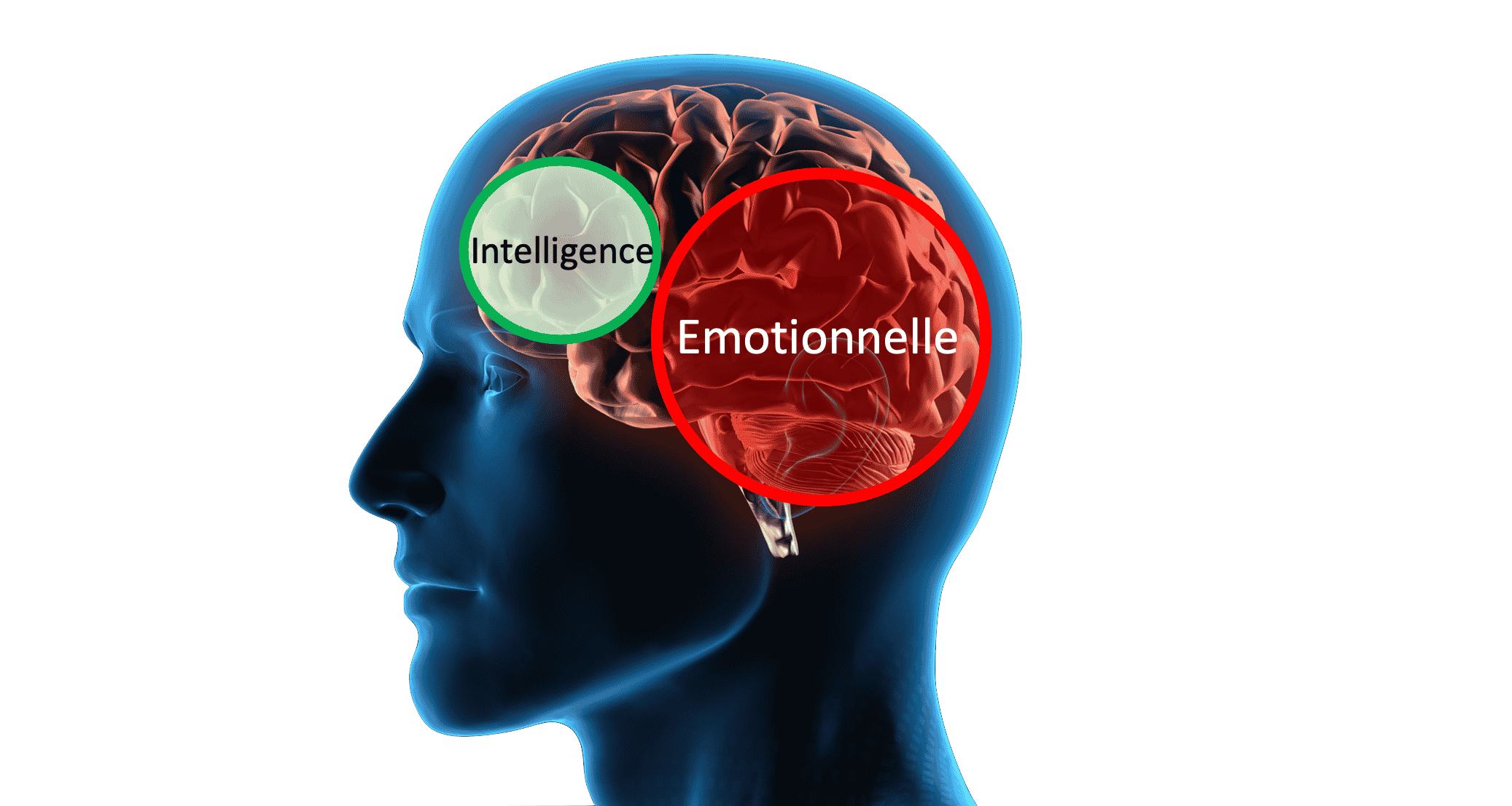
L’intelligence émotionnelle, c’est bien plus que savoir si on est triste ou content.
Elle englobe quatre aptitudes essentielles : percevoir les émotions (les siennes et celles des autres), les comprendre dans leur contexte, les exprimer de manière appropriée, et les maîtriser pour adapter son comportement humain à une situation donnée.
Contrairement au quotient intellectuel (QI), centré sur les capacités cognitives, l’intelligence émotionnelle se mesure par le quotient émotionnel (QE). Cette distinction est majeure : le QI, seul, ne suffit pas à évaluer une intelligence sociale ou relationnelle. Il ignore toute une partie de la psychologie humaine liée à nos interactions avec notre entourage, nos collègues ou nos proches. Or, dans la vie professionnelle comme personnelle, la maîtrise des émotions est un skill essentiel.
Peter Salovey et John Mayer, deux psychologues américains, ont été parmi les premiers à définir l’intelligence émotionnelle au début des années 1990, dans un article paru à New York. Selon eux, l’intelligence émotionnelle est la capacité à percevoir, comprendre, réguler et exprimer ses émotions, tout en gérant celles des autres. Ce modèle a ensuite été popularisé par Daniel Goleman, puis élargi par Howard Gardner, notamment via sa théorie des intelligences multiples (incluant l’intelligence interpersonnelle et l’intelligence intrapersonnelle). Certains modèles parlent même aujourd’hui d’un modèle mixte, intégrant des aspects de personnalité, d’intelligence artificielle ou encore d’intelligence sociale.
Concrètement, l’intelligence émotionnelle repose sur cinq grands piliers :
Ce qui rend cette forme d’intelligence si précieuse, c’est qu’elle se développe. Elle peut être renforcée par l’éducation, l’expérience, des outils pratiques, ou des lectures ciblées (voir par exemple l’ISBN 978… d’ouvrages clés sur le sujet ou une systematic review récente sur ses effets). Même un adulte peut l’apprendre facilement grâce à des exercices de régulation, des retours d’expérience, ou encore l’accompagnement d’un psychologue ou coach spécialisé.
Des études démontrent que dans un environnement professionnel, une forte intelligence émotionnelle est souvent un signe de leadership efficace, de performance collective, et d’adaptation aux changements – là où le QI ne suffit plus. C’est un point de vue aujourd’hui largement partagé, autant dans les organisations que dans les ressources scientifiques.
En France comme ailleurs (cf. avis laissé en France ou ressource relative sur les pratiques RH), on constate une prise de conscience croissante sur le rôle de cette forme d’intelligence dans la gestion des talents, du stress, ou des situations sensibles.
Alors, si vous vous demandez pourquoi on accorde aujourd’hui autant d’attention à l’intelligence émotionnelle au travail, c’est simple : elle est devenue une clé essentielle de la performance humaine dans un monde complexe. "More than IQ", dirait-on outre-Atlantique.
L'intelligence émotionnelle transforme littéralement la vie de ceux qui la développent. Les recherches le confirment : les personnes dotées d'une haute intelligence émotionnelle naviguent mieux dans leurs relations et gèrent plus efficacement leur stress au quotidien.
Le premier bénéfice, et peut-être le plus visible, concerne la gestion du stress. Quand on comprend ses émotions, on évite les réactions impulsives qui nous font souvent regretter nos paroles ou nos actes. Cette maîtrise émotionnelle permet de rester calme dans les situations tendues et de prendre des décisions plus réfléchies. Résultat ? Moins de burn-out, moins d'anxiété, et une meilleure estime de soi.
Sur le plan relationnel, l'impact est tout aussi remarquable. L'empathie développée grâce à l'intelligence émotionnelle facilite la communication et aide à résoudre les conflits plus rapidement. Au travail, cela se traduit par des équipes plus soudées et une atmosphère plus sereine. Les personnes émotionnellement intelligentes créent naturellement des liens plus solides avec leurs collègues : un bon moyen d'éviter les démissions silencieuses par exemple.
Dans le domaine professionnel, les chiffres parlent d'eux-mêmes : 85 % des compétences clés des leaders dépendent de l'intelligence émotionnelle. Cette capacité à comprendre et influencer positivement les autres devient un atout majeur pour motiver une équipe et obtenir de meilleurs résultats. D'ailleurs, certaines études suggèrent que l'intelligence émotionnelle peut être plus déterminante pour le succès professionnel que le quotient intellectuel traditionnel.
La prise de décision s'améliore également. En intégrant à la fois les aspects rationnels et émotionnels d'une situation, on évite les biais (comme les biais de recrutement) et on prend des décisions plus équilibrées. Cette approche favorise aussi l'adaptabilité face aux changements, une qualité précieuse dans notre monde en constante évolution.
Enfin, l'intelligence émotionnelle contribue au bien-être général. Elle influence positivement la santé mentale et même physique, car une meilleure gestion des émotions réduit les tensions et le stress chronique.
Mais comprendre les bénéfices de l'intelligence émotionnelle n'est qu'un début : encore faut-il savoir comment la mettre concrètement en pratique, que ce soit dans la vie de tous les jours ou au sein de l'entreprise.
L'intelligence émotionnelle trouve sa place dans tous les aspects de notre vie, des relations personnelles aux défis professionnels. Au quotidien, elle nous aide à mieux gérer nos réactions face aux difficultés, à communiquer plus efficacement avec nos proches et à nous adapter aux changements inattendus. En entreprise, c'est un atout précieux pour le management d'équipe, la résolution de conflits et les négociations délicates.
Un leader émotionnellement intelligent transforme radicalement la dynamique de son équipe. Daniel Goleman, pionnier de ce domaine, démontre que l'intelligence émotionnelle constitue un facteur déterminant de la réussite managériale et influence de manière significative la performance globale des organisations. L'intelligence émotionnelle fait partie des principales qualités d'un bon manager.
Concrètement, ces leaders excellent dans plusieurs domaines clés. Ils savent inspirer et motiver leurs collaborateurs en comprenant leurs besoins individuels. Leur capacité d'empathie leur permet de détecter les tensions avant qu'elles n'explosent. Et leur maîtrise émotionnelle les aide à garder leur calme dans les situations difficiles.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les équipes dirigées par des managers avec une intelligence émotionnelle élevée voient leur engagement augmenter de 50%. Le turnover diminue de 20 à 30%, tandis que la productivité grimpe de 20 à 36%.
Chez Google, le projet Oxygen a montré qu'investir dans l'intelligence émotionnelle des managers augmentait la satisfaction des employés de 30% et réduisait le turnover de moitié. Microsoft, sous la direction de Satya Nadella, a vu sa productivité bondir de 21% grâce à une approche plus empathique du leadership.
L'intelligence émotionnelle favorise donc la dynamique de groupe, renforce la persuasion et répond aux vrais besoins des collaborateurs.
Voici les méthodes concrètes pour améliorer votre intelligence émotionnelle de manière progressive et durable.
Commencer par soi-même
Le point de départ, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Ne refoulez pas vos émotions quand elles surgissent. Au contraire, prenez le temps de les identifier et de les nommer précisément. "Je suis énervé" peut devenir "je me sens frustré parce que je n'arrive pas à me faire comprendre".
Cette précision dans le vocabulaire émotionnel fait toute la différence. Plus vous saurez verbaliser vos ressentis, mieux vous pourrez les gérer.
Développer son recul émotionnel
Évitez les jugements rapides sur les situations ou les personnes. Quand quelque chose vous contrarie, prenez du recul. Remettez les choses en perspective. Cette réaction est-elle proportionnée ? Y a-t-il d'autres façons de voir la situation ?
Assumez aussi vos erreurs sans vous flageller. Elles font partie de l'apprentissage et vous aident à mieux vous comprendre.
Techniques concrètes à adopter
Plusieurs pratiques peuvent accélérer votre développement :
Travailler son intuition et son écoute
Votre intuition est un guide précieux. Apprenez à l'écouter et à faire confiance à vos premières impressions sur les gens et les situations. En parallèle, développez votre capacité d'écoute. Posez des questions ouvertes, reformulez ce que vous entendez, montrez que vous cherchez vraiment à comprendre.
Quand demander de l'aide
Parfois, des blocages émotionnels profonds freinent votre développement. Un accompagnement thérapeutique peut alors s'avérer nécessaire. Un professionnel vous aidera à identifier et surmonter ces obstacles pour développer pleinement votre intelligence émotionnelle.
L'important, c'est de commencer quelque part et d'être patient avec vous-même. Chaque petit progrès compte.
Mais comment savoir où vous en êtes réellement dans ce cheminement, et mesurer vos avancées de façon concrète ? C'est là qu'entrent en jeu différents outils et tests, conçus pour évaluer votre intelligence émotionnelle et vous guider dans votre progression.
Plusieurs outils fiables permettent d'évaluer votre niveau d'intelligence émotionnelle de façon précise.
Les tests de performance comme le MSCEIT ou le QEPro® mesurent vos capacités réelles. Ils vous proposent des situations concrètes et évaluent vos réponses selon des critères objectifs. Ces outils sont plus fiables que les simples questionnaires d'auto-évaluation.
Le test EQI (Emotional Quotient Inventory) reste une référence. Il mesure l'intelligence émotionnelle via 5 composantes principales et nécessite un débriefing par un coach certifié pour être vraiment efficace. De même, le test EQ-i 2.0 permet d'évaluer l'intelligence émotionnelle de manière fiable.
Ces tests analysent généralement quatre domaines clés : la conscience de soi, la maîtrise de soi, la conscience sociale et la gestion des relations. Vous obtenez un profil détaillé avec vos forces et vos axes d'amélioration.
L'avantage ? Ces outils vous donnent une base solide pour construire un plan de développement personnalisé. Ils permettent aussi de mesurer vos progrès dans le temps. Comptez entre 30 et 60 minutes pour passer un test complet. Pour tirer pleinement parti de ces outils et interpréter correctement vos résultats, il est essentiel de bien comprendre chacune des composantes de l'intelligence émotionnelle qu'ils évaluent.
Pour bien comprendre l'intelligence émotionnelle, il faut d'abord connaître ses différentes facettes. Ces composantes fondamentales, définies par Daniel Goleman, constituent les piliers essentiels qui déterminent notre capacité à comprendre et gérer nos émotions ainsi que celles des autres. Chacune de ces dimensions joue un rôle spécifique dans notre capacité à naviguer avec succès dans nos relations et nos défis quotidiens.
L'empathie constitue le pilier central de l'intelligence émotionnelle. Cette capacité à percevoir et comprendre les émotions d'autrui transforme radicalement nos interactions quotidiennes.
Concrètement, l'empathie se manifeste sous deux formes distinctes. L'empathie émotionnelle nous fait ressentir ce que vit l'autre personne. L'empathie cognitive, elle, nous permet de comprendre ses pensées et sentiments sans forcément les éprouver nous-mêmes. Cette seconde forme s'avère particulièrement précieuse dans les métiers d'aide, où elle protège de l'épuisement émotionnel.
Cette compétence offre un avantage considérable : elle permet d'anticiper les réactions des autres. Vous pouvez ainsi adapter votre communication, éviter les malentendus et améliorer vos relations sociales et professionnelles. Un manager empathique détecte plus facilement les tensions dans son équipe. Un commercial empathique cerne mieux les besoins de ses clients.
Les recherches révèlent des aspects fascinants sur l'empathie. Une étude génétique récente a identifié 11 loci liés à cette capacité. Environ 10% de nos différences empathiques proviennent de notre patrimoine génétique. Le reste dépend de notre environnement, notre éducation et nos expériences. Les femmes présentent généralement un quotient empathique plus élevé, résultat de facteurs biologiques et environnementaux combinés.
En milieu professionnel, l'empathie devient un véritable levier de performance. Elle renforce la confiance au sein des équipes, facilite la collaboration et améliore la gestion des conflits. Les entreprises dirigées par des managers empathiques enregistrent un taux de rétention des employés supérieur de 40% à la moyenne du secteur. Les collaborateurs se sentent mieux compris, plus engagés et donc plus productifs.
La bonne nouvelle ? L'empathie se développe. Des techniques comme l'écoute active, l'observation du langage corporel ou encore l'auto-évaluation régulière permettent de renforcer cette compétence. Chaque interaction devient alors une opportunité d'améliorer sa capacité empathique.
L'empathie n'est pas un bloc monolithique. Elle se divise en deux formes distinctes qui fonctionnent différemment.
L'empathie émotionnelle vous fait littéralement ressentir ce que vit l'autre personne. Quand votre collègue est stressé, vous sentez cette tension dans votre corps. C'est viscéral, automatique. Vous partagez réellement l'émotion.
L'empathie cognitive, elle, reste dans la compréhension intellectuelle. Vous saisissez parfaitement que votre collègue est stressé et pourquoi, mais vous gardez votre distance émotionnelle. Vous analysez la situation sans vous laisser envahir.
Cette distinction change tout dans la pratique :
Les deux ont leur place. L'empathie émotionnelle excelle pour consoler et créer du lien. L'empathie cognitive brille quand il faut prendre des décisions rationnelles tout en tenant compte des émotions d'autrui.
Développer les deux vous donne une palette complète pour naviguer dans vos relations.
Trois modèles dominent la recherche sur l'intelligence émotionnelle depuis les années 1990. Chacun apporte sa vision unique de cette compétence.
Le modèle de Mayer et Salovey : les quatre branches
Ces deux chercheurs américains ont posé les bases théoriques en 1990. Ils définissent l'intelligence émotionnelle comme une capacité cognitive qui se divise en quatre branches :
Ce modèle traite les émotions comme une information. Il met l'accent sur les capacités mentales plutôt que sur les traits de personnalité.
Le modèle de Daniel Goleman : l'approche managériale
Goleman a popularisé le concept en 1995 avec une approche plus large. Son modèle comprend cinq piliers essentiels qui mélangent capacités émotionnelles et compétences sociales :
Une particularité intéressante : selon Goleman, le cerveau lié à l'intelligence émotionnelle est le dernier à arriver à maturité. Il se façonne par les expériences répétées tout au long de la vie.
Le modèle de Bar-On : l'équilibre émotionnel
Reuven Bar-On propose en 1997 un modèle centré sur le bien-être émotionnel. Il identifie cinq composantes principales :
Ce modèle est souvent utilisé en psychologie du travail pour améliorer le bien-être des employés.
Des approches complémentaires
Ces trois modèles ne s'opposent pas. Ils éclairent différents aspects de l'intelligence émotionnelle. Mayer et Salovey se concentrent sur les capacités cognitives. Goleman privilégie l'application pratique en entreprise. Bar-On met l'accent sur l'équilibre personnel.
Chaque modèle a donné naissance à des outils de mesure spécifiques. Le MSCEIT pour Mayer et Salovey, l'ECI pour Goleman, et l'EQ-i 2.0 pour Bar-On.

pour ne louper aucune de nos actus